Extraits de Voyage en Algérie publié en 1910 par M.Meunier
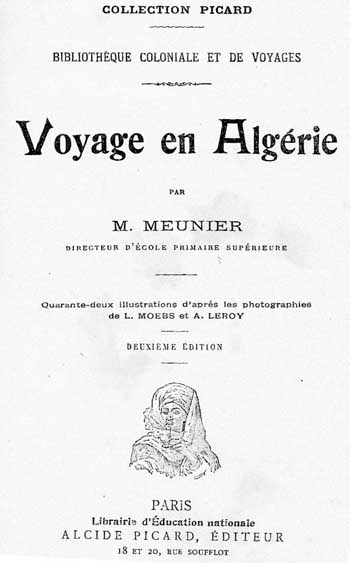
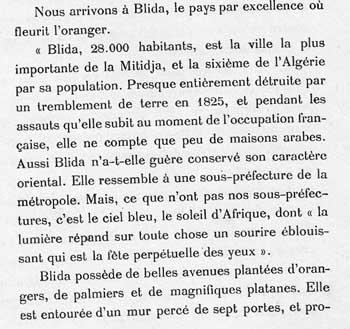
« Blida, 28.000 habitants, est la ville la plus importante de la Mitidja, et la sixième de l'Algérie par sa population. Presque entièrement détruite par un tremblement de terre en 1825, et pendant les assauts qu'elle subit au moment de l'occupation française, elle ne compte que peu de maisons arabes. Aussi Blida n'a-t-elle guère conservé son caractère oriental. Elle ressemble à une sous-préfecture de la métropole. Mais, ce que n'ont pas nos sous-préfectures, c'est le ciel bleu, le soleil d'Afrique, dont « la lumière répand sur toute chose un sourire éblouissant qui est la fête perpétuelle des yeux ».
Blida possède de belles avenues plantées d'orangers, de palmiers et de magnifiques platanes. Elle est entourée d'un mur percé de sept portes, et protégée par le fort Mimich qui domine la plaine. A une faible distance, coule l'Oued-el-Kébir, ou Grand Fleuve, aux eaux abondantes, sur lequel on a construit des minoteries, des pressoirs à huile et des fabriques de pâtes alimentaires et de papier.
Un dépôt de remonte occupe tout un quartier de la ville. Des boxes y sont aménagés, qui peuvent contenir 500 étalons. L'installation de cet établissement est remarquable. On y voit de jolis chevaux pur sang arabe et principalement des barbes.
Tous ces chevaux sont installés en plein air, abrités seulement par un toit contre les averses ou contre les ardeurs du soleil : ce détail en dit long sur le climat de la contrée.
Le quartier indigène, de date récente comme la ville européenne, est relativement bien construit : les rues y sont larges, bien alignées et propres, mais sans cachet. Des maisons basses présentent régulièrement leurs petites échoppes servant de magasins ou d'ateliers.
Les métiers y sont groupés par rues : ici les marchands de comestibles, plus loin les négociants en tissus; dans une autre rue, les forgerons dont l'enclume résonne à nos oreilles, tandis qu'en face les menuisiers poussent la varlope; ailleurs, des hommes accroupis brodent en silence, avec des fils d'argent, des porte-monnaie en maroquin. Et toujours, à côté de quelques travailleurs, beaucoup de paresseux.
Dans toute la ville les indigènes paraissent jouir d'un bien-être que nous n'avons pas rencontré ailleurs ; ils ont les traits moins étirés ; ils sont moins loqueteux, et leurs burnous sont presque blancs.
Les autres curiosités de Blida sont le superbe jardin Bizot, puis le Bois Sacré, véritable forêt d'oliviers plusieurs fois séculaires, gros comme des. noyers, sous lesquels s'abritent des ficus et des mimosas. Ces troncs antiques, ces branches noueuses et tordues, ce feuillage épais que traversent de rares éclairs de lumière font penser aux forêts de la Gaule que fréquentaient les druides. La présence sous ces ombrages d'une kouba ne contribue pas peu à cette idée.
Le monument a été élevé à la mémoire du marabout Sidi-Yacoub. C'était un pauvre diable vivant, d'aumônes; sa vie toute d'austérité et de folie mystique a fait passer son nom à la postérité. Sous la coupole bleue où reposent ses cendres, brûle constamment une pâle veilleuse. Par la porte grande ouverte, nous avons pu voir les indigènes des deux sexes, les pieds nus, accroupis autour de son tombeau. Un iman de sixième ordre, en des sons gutturaux, adressait des invocations à Allah. J'ai compris les élans de sa prière, après qu'on m'eut expliqué qu'il recevait les offrandes faites au saint, et qu'il en vivait. Et je n'ai pu m'empêcher de penser que dans tous les pays la foi appelle l'exploitation. (Dagand )
Quand on va à Blida, une promenade à la Chiffa est de tradition. Et cependant les gorges le cèdent en pittoresque à celles des Portes de Fer et de Palestro. Mais on court la chance d'y rencontrer des singes. Je dois à la vérité de dire que nous fûmes des mieux partagés, car nous en vîmes plus de quarante. Ils étaient à 100 mètres au plus du restaurant dit « Ruisseau des Singes », dans l'étroit vallon, bien boisé, qui porte le même nom. Sans doute ils étaient venus en troupe s'abreuver au ruisseau qui dégringole en cascades successives de la montagne. Deux petits sont assis en face l'un de l'autre et se taquinent. Ils avancent leurs pattes, les retirent. On dirait qu'ils jouent aux cartes. Nous sommes séparés d'eux par le ruisseau, large en cet endroit d'une dizaine de mètres, et notre présence ne les effarouche pas trop. De plus grands vont, viennent, circulent à travers les branches, nous regardent curieusement. Mais bientôt tous les membres de la caravane arrivent, à la nouvelle que les singes sont là. C'est trop de monde, sans doute, pour nos quadrumanes, car bientôt ils escaladent les rochers, les petits suivant les plus grands, et le dernier disparaît derrière les arbres des sommets.
De singes, il ne reste plus que deux captifs dans une cage de l'auberge. Ils ont été pris à l'aide de pièges. Ils tendent une patte avide vers une orange qu'ils aperçoivent dans le capuchon du plaid de Mme Leroy. L'un d'eux la saisit et la partage en deux moitiés, mais... pour lui seul. L'autre se risque à prendre une pelure; le premier saute sur lui et le mord impitoyablement, sans le lâcher, pendant deux ou trois secondes au moins. Oh ! le vilain singe! Il est aussi méchant que certains hommes.
Et maintenant, à fond de train sur la gare de Blida, et en route pour Alger.